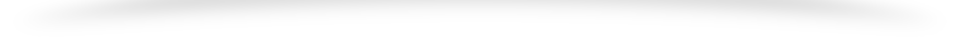Cap Horn : un mythe s’effondre
 Mardi 28 janvier: nous venons de passer le Cap Horn sans un pet de vent, au moteur, sous peine de ne jamais y arriver, sans une vague rugissante, avec 16 degrés de température et un long rayon de soleil. Désappointement : nous ne pourrons pas raconter les rafales hurlantes, les lames soulevant le bateau pour aller se fracasser contre la falaise, les voiles bordées, le champagne qui saute alors que nous filons à toute vitesse dans l’océan déchaîné. Le Champagne, nous l’avons tout de même fait sauter, histoire de marquer le coup, celui d’un passage sans histoire. Pour le mythe, il nous faudra revenir pour trouver une autre vision de cette montagne pelée autour de quelques rochers hirsutes qui émergent de l’immensité d’un infini bleu acier. Mais aujourd’hui, c’est vrai, l’océan antarctique se donne des airs de Méditerranée.
Mardi 28 janvier: nous venons de passer le Cap Horn sans un pet de vent, au moteur, sous peine de ne jamais y arriver, sans une vague rugissante, avec 16 degrés de température et un long rayon de soleil. Désappointement : nous ne pourrons pas raconter les rafales hurlantes, les lames soulevant le bateau pour aller se fracasser contre la falaise, les voiles bordées, le champagne qui saute alors que nous filons à toute vitesse dans l’océan déchaîné. Le Champagne, nous l’avons tout de même fait sauter, histoire de marquer le coup, celui d’un passage sans histoire. Pour le mythe, il nous faudra revenir pour trouver une autre vision de cette montagne pelée autour de quelques rochers hirsutes qui émergent de l’immensité d’un infini bleu acier. Mais aujourd’hui, c’est vrai, l’océan antarctique se donne des airs de Méditerranée.
Premier enseignement de ce périple : tout le monde peut devenir cap-hornier
Deuxième enseignement : les phoques, ça pue. Ça pue grave, comme dirait mon fils. A une vingtaine de mètres de l’îlot où ils étalent leur graisse informe et malodorante, on tombe, même au milieu de la mer et du vent.
Troisième enseignement : le bonheur est effectivement quelque chose de très relatif : On peut vivre dans le trou-du-cul du monde, entre un mémorial, un monument aux morts, un phare et une chapelle en bois, et s’en trouver bien
C’est le cas d’Ingrid et d’Hector, le couple de gardien du phare et de l’île du Horn, qui vivent là, au sommet de cette colline, vue imprenable sur la mer, dans une charmante casetta en bois, bien arrimée à la terre par de solides câbles: il paraît que le vent souffle fort au Cap Horn.
 Ingrid et Hector, leurs deux chiens, leur chat. Leur sourire, leur accueil. Ils sont là pour un an. Le va-et-vient de quelques navires et de leurs visiteurs, marins de passage, leur suffit. La solitude ça n’existe pas. Surtout quand il y a la télé.
Ingrid et Hector, leurs deux chiens, leur chat. Leur sourire, leur accueil. Ils sont là pour un an. Le va-et-vient de quelques navires et de leurs visiteurs, marins de passage, leur suffit. La solitude ça n’existe pas. Surtout quand il y a la télé.
C’est peut-être la télé qui est justement la cause du court-circuit qui a mis le feu à une maison de Puerto Toro où nous avons rapidement mis pied à terre hier. La pluie est venue en aide à cette malheureuse famille qui a vu son toit partir en fumée. Juste le temps de sauver les meubles qui gisent sous une bâche, au milieu d’un bout de « jardin ». A Puerto Toro il y a une trentaine d’habitant et un peu moins de maisons perchées sur le haut de l’île où est cantonnée l’armée chilienne. Il y a aussi une école, donc un maître d’école, une salle de sports et une petite chapelle pour que Dieu ne les abandonne pas totalement. Parce qu’en dehors de lui, il ne faut pas trop compter sur le reste de la troupe qui débarque quelques heures plus tard pour éteindre un tas de braises fumant.
Dernier enseignement, après trois jours de voyage : il existe des algues qui se prennent pour des sirènes et ondulent gracieusement dans l’eau. On pourrait presque s’y amarrer tant elles sont robustes. Dans le cirque de montagnes où nous avons mouillé pour la deuxième nuit, face à des forêts d’arbres tordus par le vent, on se croyait dans une estampe chinoise, au milieu d’un lac de nénuphars.
Les dauphins qui nous ont suivi un bout de route, en gambadant, vous le diront : tout va bien à bord
 Jeudi, 6 heures du matin, petit coup de houle. Je roule dans le sac de couchage. Quelques notes de musique entrent par la porte de la cabine : Cat Steven ressurgit d’une lointaine époque : « It’s a wild world … » Il ne croit pas si bien dire ce vieux Cat. Ce matin nous allons gaillardement écrire notre chronique d’une mort annoncée. Avec Hannibal (le cuistot du bord) dans le rôle du tueur. Mais pour l’heure c’est à Manuel d’officier. Manuel est un solide paysan. Seul et unique habitant de Picton, l’île où nous avons débarqué hier. Enfin l’unique habitant bipède. Parce qu’il a deux chiens, Manuel, et des chevaux, et des vaches, et des cochons. Des cochons bien roses et bien dodus feraient merveille, rôtis sur la braise.
Jeudi, 6 heures du matin, petit coup de houle. Je roule dans le sac de couchage. Quelques notes de musique entrent par la porte de la cabine : Cat Steven ressurgit d’une lointaine époque : « It’s a wild world … » Il ne croit pas si bien dire ce vieux Cat. Ce matin nous allons gaillardement écrire notre chronique d’une mort annoncée. Avec Hannibal (le cuistot du bord) dans le rôle du tueur. Mais pour l’heure c’est à Manuel d’officier. Manuel est un solide paysan. Seul et unique habitant de Picton, l’île où nous avons débarqué hier. Enfin l’unique habitant bipède. Parce qu’il a deux chiens, Manuel, et des chevaux, et des vaches, et des cochons. Des cochons bien roses et bien dodus feraient merveille, rôtis sur la braise.
Donc, n’écoutant que notre ventre, depuis hier nous mijotons, comme si de rien n’était, la mise à mort sournoise d’une demoiselle cochon de 4 mois. Qui, elle, ne se doute de rien et sort avec sa truie de mère et ses frères et sœurs pour se ruer sur l’auge qu’on lui tend avec perfidie.
Hop, ni une ni deux, pas le temps même de bouffer une miette et la voilà tirée en arrière, par la main assassine de Manuel qui s’est abattue sur sa queue. Mécontentement ostentatoire de la mère, cris éperdus de l’enfant que le destin a désigné comme devant nous servir de repas. Elle hurle, la petite et elle hurle (cris d’orfraie) encore, tandis que sa mère (plongeant Marc sur dans une profonde méditation sur la permanence de l’objet vue par Piaget) s’en retourne satisfaire ses propres appétits. « Salope de mère qui n’assure rien du tout » s’est sans doute dit la victime avant qu’on lui tranche promptement la trachée et qu’on l’emmène se frotter aux flammes purificatrices du barbecue.
 On s’est régalé de la petite truie de lait. Mais en fin de journée, après avoir fait une longue promenade à travers les broussailles humides de l’île, jusqu’à un lac, après avoir léché et pourléché ses os, j’ai vu un peu plus haut sur la colline trotter son fantôme. Elle s’était réincarnée en une énorme truie qu’elle aurait pu devenir, si Dieu et nous-mêmes lui avions prêté vie.
On s’est régalé de la petite truie de lait. Mais en fin de journée, après avoir fait une longue promenade à travers les broussailles humides de l’île, jusqu’à un lac, après avoir léché et pourléché ses os, j’ai vu un peu plus haut sur la colline trotter son fantôme. Elle s’était réincarnée en une énorme truie qu’elle aurait pu devenir, si Dieu et nous-mêmes lui avions prêté vie.
« Bienvenue de l’armée chilienne à Puerto Navarrino ». Le drapeau du Chili flotte haut, avec à ses pieds la vierge. Autrefois les Indiens Yamana vivaient sur ces terres de Patagonie. Aujourd’hui il n’y a plus guère que l’armée chilienne qui fait « vivre » ces terres où les arbres courbent sous le vent, à jamais tordus, bossus, pliés, dans le même sens. Belle métaphore de ce pays, Monsieur Pinochet.
Glaciers glaçants. Glaciers cascadant du haut de la montagne, blancs et plus transparents. Glaciers dégringolants jusqu’à la mer. Grandioses, lumineux, imposants sous le soleil. Glaciers froids et distants sous la grisaille. C’est le soleil qui rend les choses belles. Tout ce qui baigne dans sa lumière vit et palpite. On a pêché un glaçon pour pouvoir déguster un apéro « on the rocks » au soleil, face à la gigantesque cascade de glace d’Italia, glacier ensoleillé, naturellement !
 2ème rencontre avec les phoques : ça pue toujours autant, ça n’a pas maigri et c’est toujours aussi disgracieux. Sauf quand on ne voit que leur tête sortir de l’eau. Je ne pense pas avoir d’affection particulière pour les phoques. Impression confirmée après une observation intensive et minutieuse de ces mammifères obèses et de leur « way of life ». Non seulement ils vivent dans une société de parfaits machos (du genre gros dégueulasse), mais en plus ils sont agressifs, ils ont une vision tout à fait réac de la notion de territoire, du genre du « t’approche un peu trop de l’endroit où j’étale ma graisse et je te mords ».
2ème rencontre avec les phoques : ça pue toujours autant, ça n’a pas maigri et c’est toujours aussi disgracieux. Sauf quand on ne voit que leur tête sortir de l’eau. Je ne pense pas avoir d’affection particulière pour les phoques. Impression confirmée après une observation intensive et minutieuse de ces mammifères obèses et de leur « way of life ». Non seulement ils vivent dans une société de parfaits machos (du genre gros dégueulasse), mais en plus ils sont agressifs, ils ont une vision tout à fait réac de la notion de territoire, du genre du « t’approche un peu trop de l’endroit où j’étale ma graisse et je te mords ».
L’ennui c’est que comme ils sont de surcroît grégaire, ils ont tendance à s’agglutiner dans le même périmètre, en se bouffant constamment le nez. Décidément, le phoque est le dernier animal dans lequel je voudrais me réincarner. Il n’a vraiment rien pour lui, pas même sa voix qui varie du grognement de cochon au bêlement de mouton, en passant par des cris de basse-cour. Il n’y a que le spectacle des mères avec leurs petits (plutôt mignons) qui me réconcilie avec les phoques (dont je ne sait pas d’où vient leur réputation de pédé, puisqu’ils vivent plutôt avec un harem).
Pourquoi je m’appesantis autant sur le phoque ?
-Parce que ce sont les seuls être vivants que nous avons rencontrés depuis Manuel et ses cochons (je ne tiens pas compte de la téléphoniste de Puerto William où nous sommes passés en coup de vent pour appeler le pays).
Depuis ce vendredi, la rencontre a lieu avec les glaciers. Mer de glace et murs de glace en roches transparentes et bleutées, en vaguelettes raidies par le froid, en turlututu chapeau pointu. Immenses, gigantesques, spectaculaires. Craquant, vêlant, expulsant avec fracas des pans entiers de leur paroi, expulsant leur grenaille avec des détonations et des claquements de fusils. Transparents et ombrageux, silencieux et tonitruants, prêt à engloutir la mer et à se faire engloutir, à faire craquer la montagne qui les enserre dans ses flancs, à dégueuler cette glace bleutée qui flotte éparse sur l’eau, comme des milliers de poissons. Glaces éparpillées, catapultées qui se figent dans ces formes naturelles d’animaux de la mer, entre lesquels le bateau se fraie un chemin, en cognant parfois un mini iceberg avec un bruit rugueux.
Les montagnes, les glaciers : ici c’est l’éternité
Le désert : c’est l’infini.
Sylvie Cohen
Février 2003